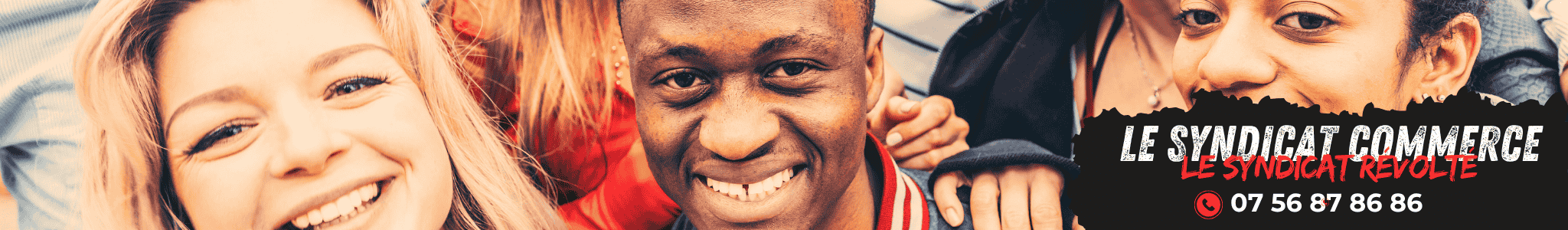Le mi-temps thérapeutique
Le cadre légal du mi-temps thérapeutique
Le mi-temps thérapeutique permet à un salarié malade de reprendre son travail tout en restant indemnisé. Ce dispositif, prévu par le Code de la sécurité sociale, favorise la rééducation ou la réadaptation professionnelle. Il aide le salarié à retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Depuis le 1er janvier 2019, ce dispositif s’applique sans qu’un arrêt de travail préalable soit nécessaire. Ainsi, le salarié peut en bénéficier dès l’apparition d’un problème de santé. Cette évolution résulte de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 relative au financement de la sécurité sociale.
Pour être valable, le mi-temps thérapeutique doit être autorisé par le médecin traitant et le médecin-conseil. Le salarié doit informer sa caisse primaire d’assurance maladie et fournir deux documents : une attestation de l’employeur indiquant la nature de l’emploi et un certificat médical d’autorisation. De plus, le salarié doit préciser la rémunération prévue pendant la période de travail à temps partiel.
Le montant de l’indemnité journalière ne peut dépasser la perte de revenu liée à la réduction du temps de travail. La durée des versements ne peut excéder un an, en plus des trois ans d’indemnisation maximale pour arrêt maladie. Ainsi, la durée totale de versement peut atteindre quatre ans.
Le mi-temps thérapeutique et le droit du travail
Le Code du travail ne définit pas expressément le mi-temps thérapeutique. Cependant, il considère le salarié concerné comme travaillant temporairement à temps partiel pour raison médicale. Ce régime modifie la durée du travail et nécessite l’accord du salarié et de l’employeur.
En pratique, le médecin du travail ou le médecin traitant propose souvent la reprise à temps partiel. Pourtant, l’employeur peut refuser cette organisation si elle désorganise l’entreprise. Dans ce cas, il doit motiver son refus par écrit et le transmettre au salarié et au médecin du travail.
Conformément à l’article L.4624-6 du Code du travail, l’employeur doit justifier son refus. S’il persiste à refuser malgré les préconisations médicales, il peut contester l’avis du médecin du travail. Cette contestation se fait devant le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond.
Le SCID estime que l’employeur a tout intérêt à organiser une visite médicale avant toute reprise. Cette démarche permet de vérifier la compatibilité de l’état de santé du salarié avec le travail envisagé. En outre, un avenant au contrat de travail reste indispensable. Cet avenant fixe la durée du travail applicable et sa répartition durant la période de mi-temps thérapeutique.
Le terme du mi-temps thérapeutique
Le terme « mi-temps » ne signifie pas obligatoirement 50 % du temps de travail habituel. La durée peut être supérieure ou inférieure selon les recommandations médicales. Généralement, l’avenant au contrat est conclu pour une durée limitée, renouvelable si nécessaire.
À la fin de cette période, une visite médicale de reprise s’impose. Sous réserve de l’avis du médecin du travail, le salarié reprend alors son activité normale.
Le licenciement et la jurisprudence
Le contrat d’un salarié en mi-temps thérapeutique n’est pas suspendu. Ainsi, il ne peut prétendre aux dispositions conventionnelles sur le maintien du salaire pendant un arrêt maladie. Il perçoit sa rémunération pour la partie travaillée, complétée par les indemnités journalières.
En l’absence de règles spécifiques dans le Code du travail, les droits du salarié s’apprécient comme ceux d’un salarié à temps partiel. Cela concerne notamment l’ancienneté, les congés payés ou les titres-restaurant.
Toutefois, la Cour de cassation reconnaît l’originalité du mi-temps thérapeutique. Dans un arrêt du 20 septembre 2023 (Cass. soc., n°22-12.293), elle juge que cette période doit être assimilée à une période de présence. Ainsi, le salaire à retenir pour calculer la participation correspond au salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique.
Concernant le licenciement, la Cour a précisé sa position dans plusieurs arrêts récents. Le 12 juin 2024 (Cass. soc., n°23-13.975), elle a indiqué que le salaire de référence est celui précédant le mi-temps thérapeutique. Elle a confirmé cette position le 5 mars 2025 (Cass. soc., n°23-20.172).
Selon cette jurisprudence, la période de mi-temps thérapeutique doit être neutralisée pour le calcul de l’indemnité de licenciement. Le salaire pris en compte est donc celui antérieur au passage à temps partiel pour motif médical. Cette solution repose sur le principe de non-discrimination lié à l’état de santé.
De plus, l’article L.3123-5 du Code du travail précise que l’indemnité de licenciement doit être proportionnelle aux périodes d’emploi à temps complet et à temps partiel. Pourtant, la Cour de cassation écarte cette règle lorsque la réduction du temps de travail découle d’un motif médical. Le mi-temps thérapeutique se distingue donc clairement du temps partiel classique.
Position du SCID
Le SCID estime que ces décisions consacrent l’originalité du mi-temps thérapeutique. Ce dispositif échappe en partie au droit commun du travail à temps partiel. Cependant, cette situation crée une insécurité juridique pour les salariés comme pour les employeurs.
Le SCID considère qu’une clarification législative s’impose. Une définition claire du mi-temps thérapeutique dans le Code du travail permettrait de sécuriser son régime. Elle garantirait également une meilleure égalité de traitement entre salariés.
Le SCID réaffirme sa volonté de replacer l’humain au centre des décisions. La santé du salarié doit primer sur les contraintes organisationnelles. En conséquence, nous appelons le législateur à agir pour reconnaître pleinement la spécificité du mi-temps thérapeutique.
Sources
- Cass. soc., 5 mars 2025, n°23-20.172
- Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-13.975
- Cass. soc., 20 septembre 2023, n°22-12.293
- Code de la sécurité sociale, art. L.323-3 et R.433-15
- Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code du travail, art. L.4624-6 et L.3123-5